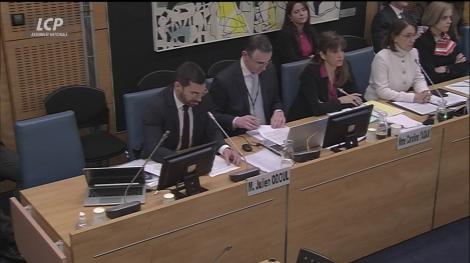Une proposition de loi pour renforcer la "lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur" examinée en commission

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale examine, ce mercredi 30 avril, une proposition visant à lutter "contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur". Les députés Pierre Henriet (Horizons) et Constance Le Grip (Ensemble pour la République) en sont les deux co-rapporteurs. Le texte a déjà été adopté par le Sénat, à l'unanimité, le 20 février.
Les députés de la commission des affaires culturelles et de l'éducation se penchent, ce mercredi 30 avril au matin, sur la proposition de loi relative à "la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur", portée par Pierre Henriet (Horizons) et Constance Le Grip (Ensemble pour la République). Ce texte, sur lequel le gouvernement a engagé une procédure accélérée, a été adopté à l'unanimité au Sénat le 20 février. A l'Assemblée nationale, après son passage en commission, il sera examiné dans l'hémicycle la semaine du 5 mai.
La proposition de loi entend mettre en place une "sensibilisation obligatoire" à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme au sein des missions de formation tout au long du parcours éducatif, dans les établissements d’enseignement supérieur, mais aussi dans les écoles, les collèges et les lycées, ainsi que dans les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ). Elle renforce les dispositifs de prévention et de signalement des faits discriminatoires, en instaurant, par exemple, des "référents" dédiés à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme au sein des établissements. Elle élargit, en outre, le cadre d'action des instances disciplinaires et améliore la prise en compte des victimes.
Le texte prévoit la création d'une section disciplinaire commune aux établissements d'une même région académique, présidée par un magistrat administratif, pour "mutualiser" la charge disciplinaire entre les établissements. Cela permettrait aux chefs d'établissements d'externaliser le processus disciplinaire sur les dossiers les plus sensibles.
Issue d'une mission sénatoriale
Cette proposition de loi est issue des onze recommandations d'une mission d'information "flash", dont les conclusions avaient été rendues le 26 juin 2024 par les sénateurs Pierre-Antoine Levi (Les Centristes) et Bernard Fialaire (Parti radical) – qui avaient par la suite été désignés co-rapporteurs du texte au Sénat. La mission avait été lancée après les accusations d'antisémitisme ayant accompagnées la tenue d'une conférence pro-palestinienne à Sciences Po Paris.
Les nombreuses manifestations pro-palestiniennes dans les universités françaises après les attaques du 7-Octobre "ont donné lieu à des dérapages reposant sur l'assignation d'étudiants juifs à Israël", soulignaient les sénateurs pour expliquer la nécessité de légiférer. Indiquant que les actes antisémites recensés dans les établissements d'enseignement supérieur avaient doublé, la commission de la culture et de l'éducation du Sénat évoquait "un antisémitisme à bas bruit". Depuis le 7-Octobre, "ce que nous voyons dans nos universités n'est pas seulement la résurgence des propos haineux, mais l'étouffement progressif de nos valeurs humanistes", avait déclaré Pierre-Antoine Levi, souhaitant la protection de certains "concitoyens des espaces de peurs, d'exclusion et de haine" dans l'enseignement supérieur.
Lors de l'examen du texte au Sénat, le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, s'était dit favorable à la proposition de loi pour faire face à "une atmosphère pesante pour les étudiants juifs", annonçant du même coup le lancement d'un "programme de recherche spécifique sur l'antisémitisme".
Un rapport remis au gouvernement
Un rapport issu des Assises de la lutte contre l'antisémitisme a été remis, lundi 28 avril, à la ministre chargée de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, en présence d'Elisabeth Borne, ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce rapport doit "nous permettre d’œuvrer efficacement dans la lutte contre l'antisémitisme" et contre le risque de son "réenracinement dans la société", a déclaré Aurore Bergé, lors d'une conférence de presse. "Ce qui était très important c'est de le faire dans un contexte universaliste" parce que les différentes formes de haine doivent être traitées sans "distinction et sans hiérarchie", a-t-elle poursuivi.
Le rapport rédigé par Marie-Anne Matard-Bonucci, de l'université Paris-8, et le conseiller d'Etat Richard Senghor, préconise notamment de créer un institut de formation et de recherche sur le racisme et l'antisémitisme, de mettre en place dans les écoles, collèges et lycées "un réseau de référents-établissement", ou encore d'inclure dans les épreuves de concours des enseignants des sujets spécifiques à la lutte contre l'antisémitisme et tous les racismes.
Il préconise aussi de "recontextualiser l'histoire des antisémitismes et des racismes dans les programmes scolaires" et de former tous les agents publics à la lutte contre l'antisémitisme et tous les racismes "sur le même modèle que la formation à la laïcité".
Outre ce volet formation, le rapport suggère de davantage mesurer les actes antisémites et racistes, et d'"adapter la réponse pénale aux manifestations contemporaines des expressions à caractère antisémite pour sanctionner en particulier le détournement de la critique du sionisme à des fins antisémites".